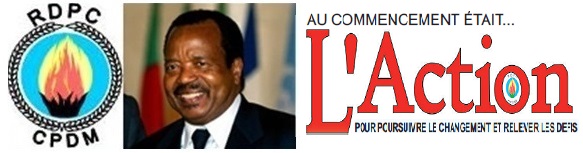La promotion de cette activité qui vise à réduire les importations de poissons a été réitéré aux responsables des services centraux et déconcentrés du Minepia par le Dr Taïga, le 24 janvier 2025 à Yaoundé.
Malgré des prédispositions naturelles exceptionnellement favorables, marquées par la disponibilité de 510 km de côtes, et d’un important réseau de cours d’eau intérieur, le Cameroun dont la production de poisson est évaluée à 245 000 tonnes en 2023, importe chaque année environ 120 000 tonnes. Un paradoxe qui a entraîné rien que pour l’année 2024, des dépenses évaluées à plus de 180 milliards de francs. Grâce au plan intégré d’Import-substitution agro-pastoral et Halieutique (Piisah) instauré par le président de la République, le Minepia tente d’inverser cette tendance par la promotion de l’aquaculture.
S’adressant à ses collaborateurs des services centraux et déconcentrés le 25 janvier 2025, le Minepia a ainsi rappelé dans le cadre de la lutte contre les importations, que «la pêche des captures devrait être renforcée mais, la solution c’est le développement de l’aquaculture, condition sine qua none de l’approvisionnement suffisant du Cameroun en produits Halieutiques ». Une orientation en phase avec la nouvelle loi régissant la pêche et l’aquaculture au Cameroun et qui accorde de nombreuses mesures incitatives. Outre l’augmentation de la zone réservée à la pêche artisanale sur les côtes camerounaises qui est désormais passée de 3 miles à 5 miles nautiques (9,26 km de la cote), on note l’exonération sur les droits de douane et la Tva des matériels et équipement aquacoles, de pêche chaque année depuis 2021, la facilitation des crédits pour les entreprises aquacoles, la vulgarisation des techniques d’aquaculture innovantes à l’instar de l’élevage en cage flottante et en bac au-sol…
Alors que l’économie camerounaise vise non seulement une croissance soutenue mais aussi une juste redistribution des fruits à travers la baisse du coût de la vie et la création d’emplois, un développement avéré de ce secteur permettrait de réduire le chômage, d’assurer sa sécurité alimentaire et d’économiser plus de 200 milliards chaque année.
Léon Marie Evina